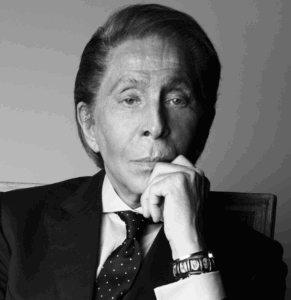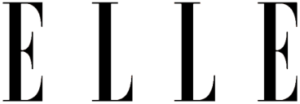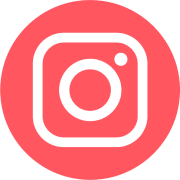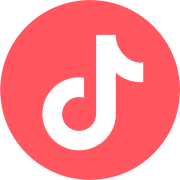Mannequins « plus size »: pourquoi la Fashion Week rétropédale
Moins de 1% des silhouettes ayant défilé durant le mois de la mode en septembre dernier dépassaient la taille S. Les créateurs de mode qui encensaient les formes curvy hier glorifient à nouveau les filiformes. Comment expliquer ce virage à 360 degrés et quels en sont les impacts sur la société? Analyse.
Jeudi 26 septembre. Alors que le temps à Paris assombrie nuages et humeurs, une lumière inattendue irradie au sein du Palais de Tokyo: « Rick Owens est revenu à ses racines! », se réjouit le public. Sa collection printemps-été 2025 déballée à la Fashion Week, a embrassé ce qui a fait sa renommée des débuts: une palette gothique, une aura poétique, et de l’avant-gardisme. Beaucoup d’avant-gardisme dispersé dans les moindres détails de ses tenues à l’image d’une audace tout aussi visible sur les silhouettes choisies. Dans ce vestiaire estival en effet, 19 des 56 looks sont portés par des mannequins dits « grandes tailles ». Au coeur des podiums de la capitale française, cette saison, Rick Owens est le seul à en avoir présentées autant.


Le geste du Yankee a d’autant plus été salué qu’il a tranché avec l’extrême minceur imposée par ses pairs. Parmi plus de 3000 tenues vues durant cette semaine de la mode, un maigre 1,7 % a surpassé la taille S. Un constat préoccupant qui n’a d’ailleurs épargné aucune capitale de la mode, poussant les experts du domaine à tirer la sonnette d’alarme:
Nous assistons à un retour inquiétant de mannequins minces à l’extrême.
C’est ce qu’ils avertissent dans le nouveau rapport sur l’inclusivité publié par Vogue Business mardi 7 octobre. D’après le magazine, Paris, mais aussi Londres, Milan et New York ont à l’unisson privilégié, pour le printemps-été 2025, les corps filiformes aux formes curvy. Avec des chiffres saisissants: « Sur les 8763 looks de 208 défilés et présentations, 0,8 % étaient de taille ‘plus' ». Il y a pourtant encore peu, la mode défilait avec fierté dans les rangs du body-positivisme. Qu’a-t-il bien pu se passer?
Diversité faussée
Né à la fin des années 1990, le mouvement a d’abord vu le jour aux Etats-Unis, dans une volonté de déconstruire les standards de beauté restrictifs. L’idée: mettre en lumière la diversité des corps. Avec l’avènement des réseaux sociaux dans les années 2010, le body-positivisme a pris une ampleur inédite, venue sauver une génération aux prises avec l’obsession de l’apparence normée qui dévorait toujours mieux ces plateformes. Historiquement ancrée dans des canons rigides, l’univers du luxe visant à séduire la jeunesse a soudainement emboîté le pas de ce militantisme. Dès 2018 alors, d’éminentes griffes telles que Savage x Fenty, la marque de lingerie de Rihanna, ont marqué les esprits avec de piquantes campagnes portant aux nues les tailles XL et les femmes enceintes. Du jamais vu à l’époque.

De nombreux autres directeurs artistiques se sont par la suite posés en fervents défenseurs de la cause inclusive. Parmi eux, Olivier Rousteing, rare directeur artistique afrodescendant d’une maison de luxe, qui, en 2019, revendiquait chez CNN son désir de « se battre pour la diversité »: « J’aime voir des silhouettes différentes ». Or, ses défilés pour Balmain ont peiné à convaincre en ce sens: s’il a certes intégré avec éclat des mannequins seniors et afrodescendants, les formes généreuses ont jusqu’à présent souvent demeuré absentes, l’intégration de son amie et chanteuse Yseult n’étant à ce jour que son unique démonstration. Même constat du côté d’Alessandro Michele, qui, en 2018, alors à la tête de Gucci, soulignait à quel point « les gens ont besoin de réalité ». Le célèbre styliste italien évoquait ainsi l’urgence d’une représentation authentique dans la mode et plus particulièrement dans les défilés. Pour autant, sa première collection Valentino, à Paris, ce jeudi 26 septembre, a curieusement fait l’impasse sur les tailles non-normées.


Stratégie gagnante… et « frustrante »
Des exemples comme celui de Balmain et Gucci, il en existe de nombreux. Saison après saison, maison après maison, l’écart entre leurs discours inclusifs et la réalité de leurs podiums se creuse toujours plus. Un décalage que le mannequin suisse au profil « plus-size » Laura Leonide explique: « Chez beaucoup de marques, la mise en lumière de corps différents n’est qu’un outil de communication visant d’abord à renforcer leur visibilité. C’est pour cela que l’on voit toujours les rares mêmes figures établies défiler telles qu’Ashley Graham ou Paloma Elsesser. Ce n’est que du marketing. » Ce qu’elle décrit porte un nom bien précis: le curve-washing. La journaliste Natalie Michie définit ce terme dans Fashion Magazine comme la tendance des marques à capitaliser sur la mouvance de l’inclusivité sans véritable engagement dans les coulisses. Une stratégie qui se voudrait lucrative puisque, comme l’indique une étude de la très respectée entreprise d’audit Deloitte publiée en 2021, 57 % des consommateurs se montrent plus fidèles aux marques affichant un engagement en faveur de la diversité. Sauf que régulièrement, comme le pointe Natalie Michie:
Au lieu de faire le nécessaire pour provoquer un véritable changement [dans l’industrie de la mode], certaines marques se tournent vers des symboles faciles, qui vide le message de son sens profond.
« Ce type de marketing prend le public pour des idiots », déplore Laura Leonide qui ne cache pas sa frustration à l’instar de la critique de Refinery29 Gina Tonic. Laquelle va plus loin: le curve-washing serait plus problématique que l’absence totale d’inclusivité, « car les marques promettent un changement qui ne se concrétise jamais. » Mais aujourd’hui, les jeux d’apparence ne sont même plus. Le luxe assume tout azimut et sans complexe un retour aux normes les plus restrictives, galvanisées par une myriade de micro-tendances.
Responsabilité sociale et morale
Parmi les nombreux styles à avoir rythmé l’année 2024, la « Y2K » a reigné en maître, mettant en joie la génération des milléniales pouvant « enfin » exhumer ses casquettes Von Dutch et autres Jeans Miss Sixty. Mais le phénomène a dans le même temps ravivé le débat autour de la représentation corporelle. En célébrant les codes esthétiques de la fin des années 1990 et du début des années 2000, la Y2K a réintroduit un idéal de beauté centré sur la minceur extrême, surtout juvénile. A la manière d’une Britney Spears dans Baby One More Time (1998) ou d’une Kate Moss dont la tailles XS l’a portée au plus haut des rangs de supermodels. Pour Laura Leonide, cette ode à la maigreur n’est pas nouvelle — elle serait même l’une des causes de son départ hors de l’Helvétie il y a quelques années.
En Europe, où la Valaisanne a longtemps tenté de se faire une place dans la mode, le marché était selon elle réticent: « J’ai compris que mon profil ne correspondait pas forcément aux demandes européennes », confie-t-elle. En 2019, elle décide alors de s’expatrier à Dubaï, à un moment où le body-positivisme étranger est à son paroxysme: l’ascension est fulgurante. Des collaborations avec Skims de Kim Kardashian, Harper’s Bazaar, Vogue propulsent cette native de Sion sur le devant de la scène du luxe. Puis 2022 sonne le retour de la tendance « Heroin Chic », cette esthétique grunge qui loue les corps aux structures osseuses proéminentes: « Les agences européennes ont soudainement arrêté de m’envoyer aux castings. En 2019, j’en faisais quatre ou cinq ; en 2023, un seul. »
Pour notre experte récemment diplômée en management d’image de marque de luxe, la question n’est pas de pointer du doigt la minceur en soi, mais plutôt de questionner l’absence de diversité dans cette industrie: « Je n’ai aucun problème avec la minceur ou tout autre type de silhouette. Je crois simplement que tous les modèles, y compris par exemple les personnes en situation de handicap ou transgenres, sont magnifiques et méritent leur place sur les podiums.» Laura Leonide en est convaincue: le changement doit donc venir en premier lieu des maisons de mode, elles qui « créent les tendances de demain et exercent un impact bien au-delà de la mode »:
Un vêtement peut embellir l’image que l’on a de soi et amplifier la confiance en soi. Les marques de luxe ont par conséquent une responsabilité sociale et morale considérable envers la clientèle et les générations futures de promovoir une mode qui leur ressemble.
A défaut d’un engagement sincère et globale qui vienne d’en haut, Laura Leonide entend bien poser sa pierre à l’édifice. Elle annonce réfléchir avec une amie à mettre en place des sortes de « bootcamps », lieux d’autovalorisation où un autre type de beauté peut triompher, celui fondé sur la confiance en soi: « Il y a une notion de rêve et de rareté que les marques de luxe cultivent (notemment en utilisant des top models), mais le danger est de finir trop loin de la réalité. Or, la beauté réside dans chaque corps. Il est important que les mannequins en soient conscients afin d’être préparés au mieux à cette industrie ».