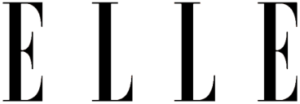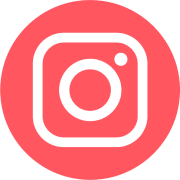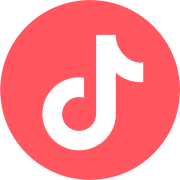Les journées sous la couette: un bonheur simple pour esprits créatifs
Envie de tout plaquer pour vous blottir sous la couette? L’autrice primée du Women’s Prize, VV Ganeshananthan, célèbre avec finesse l’art de l’hibernation et la joie réconfortante des journées passées à cocooner.

Certaines personnes tiennent à ce que la frontière entre boulot et détente soit bien nette. Moi? Pas du tout. J’ai toujours vu le travail comme une bonne excuse pour rester au lit. Surtout en hiver. Franchement, bien installé sous une couette, qu’est-ce qu’un lit sinon un manteau géant et ultra-douillet ? Aujourd’hui, je vis à Minneapolis, l’un des coins les plus glacials des États-Unis. Ici, l’hiver est si rude qu’il devient presque une invitation à hiberner. Du coup, mon lit est devenu mon bureau. J’y travaille, j’y écris, j’y rêve. Une habitude cocooning que je traîne depuis l’enfance.
Mon tout premier bureau, c’était un lit simple. Mais pas n’importe lequel: un lit à baldaquin blanc fleuri, avec un ciel de lit rose, des draps roses, une couette rose… bref, tout était coordonné. À 5 ans, j’avais même choisi un papier peint rose pour compléter le tableau, et j’ai vécu avec jusqu’à mes 18 ans. C’était bien avant que je devienne rédactrice sous le nom de VV Ganeshananthan. À l’époque, j’étais juste Sugi. Mon lit avait un bureau blanc assorti, parfait pour réviser les matières qui ne m’inspiraient pas trop mais ne m’ennuyaient pas non plus. Les sessions de travail étaient souvent boostées par des bonbons.
La seule règle sacrée? Pas de nourriture au lit, sauf en cas de maladie. Pas une consigne parentale, mais la mienne: mon lit était réservé aux livres, un sanctuaire immaculé où les miettes étaient interdites.
Comme je préférais lire allongée, écrire est naturellement devenu une activité à pratiquer sous la couette. Appuyée sur mes coudes, bien au chaud, j’écrivais comme ça des heures. Le week-end, avant même que tout le monde soit réveillé, je sortais discrètement de mon lit – en frissonnant – pour attraper un cahier d’exercices, avant de me réfugier à nouveau sous mes couvertures, mon petit cocon d’inspiration.
Quand une histoire me résistait, je posais ma tête sur l’oreiller et fermais les yeux. Pas forcément pour dormir, mais pour laisser mes idées flotter. Et ça fonctionnait: en rouvrant les yeux, le problème était soit résolu, soit devenu plus fascinant. Harriet l’espionne avait sa méthode, moi, j’étais Sugi la dormeuse.
Je me souviens encore d’une intrigue que j’avais imaginée: un mix un peu naïf à la Frances Hodgson Burnett, avec un orphelinat et un grand-père riche mystérieusement disparu, qui finissait par réapparaître au moment idéal. Je n’offrais pas de grandes fortunes aux petites héroïnes de mon histoire, mais je leur donnais ce que j’avais: le même confort douillet que je ressentais dans ce lit, que j’ai littéralement glissé dans leur aventure.
Pendant mes années d’école primaire à Bethesda, dans le Maryland, j’ai eu le privilège de choisir ma propre déco. Résultat: une chambre où tout, absolument tout, était rose. Et j’ai vécu avec ce choix pendant des années. Mes amies bavaient d’envie devant mon lit à baldaquin, et secrètement, je les comprenais: ce lit n’était pas juste un meuble, c’était une grotte, mon sanctuaire. J’y lisais, j’y écrivais, bien avant que l’ordinateur n’entre dans ma vie.
Quand l’ordinateur est enfin arrivé, au collège, j’ai dû me lever pour taper sur ce clavier qui me fascinait autant qu’il m’agaçait. Il suivait le rythme effréné de mes idées, mais adieu la position allongée. Malgré tout, le lit restait mon QG pour relire des brouillons imprimés ou dévorer des romans adorés.
Puis, direction l’université. À Harvard, comme sur de nombreux campus américains, le lit standard est extra-long. Parfait pour les basketteurs, peut-être, mais pour moi, ça voulait surtout dire plus d’espace pour travailler, parfois des heures durant. Avec mon premier ordinateur portable (pas très glamour mais efficace), j’ai renoué avec l’écriture sous la couette, affrontant les hivers glacials du Massachusetts. C’est là, blottie dans ce lit, que j’ai commencé mon premier roman, entourée de piles de papiers flottants comme des nuages.
Mes aventures littéraires m’ont ensuite menée en Pennsylvanie, en Virginie, puis dans l’Iowa, où j’ai entamé un deuxième roman avant de poser mes valises dans le New Hampshire, en tant qu’écrivaine résidente. Là, j’ai eu un appartement avec deux lits: un double dans la chambre et un simple dans le salon. Selon mon humeur – ou mon projet d’écriture – je passais de l’un à l’autre. Chaque roman semblait avoir ses préférences.
L’hiver en Nouvelle-Angleterre, comme toujours, ne faisait pas de cadeau. Je me réchauffais avec des bouteilles d’eau chaude, façon Petite maison dans la prairie, et je continuais à écrire pendant que les tempêtes de neige s’acharnaient dehors.
En 2006, je suis arrivée à New York pour étudier le journalisme artistique à Columbia. J’ai emménagé dans un duplex partagé, ma chambre nichée au sous-sol, accessible via un escalier en colimaçon. Pas de porte, juste des rideaux. Un ami, sceptique, m’a un jour lancé: « Tu vas finir par tomber de ce lit en étant bourrée. » Spoiler: je ne suis jamais tombée, malgré mes maladresses légendaires. Mon lit king size, hérité du précédent locataire, occupait presque toute la pièce. Pas d’espace pour un bureau, mais franchement, qui en avait besoin?
Ce lit king size est devenu l’endroit où j’ai littéralement réorganisé mon premier roman. Après l’avoir imprimé, je l’ai découpé et étalé sur le matelas. J’observais le chaos, réarrangeant chaque morceau jusqu’à ce que tout trouve sa place. Ce n’est qu’une fois apaisé qu’il a quitté le lit pour rejoindre mon éditeur, qui m’a confirmé que le roman tenait enfin debout. Mon lit, lui, restait là, toujours prêt à accueillir le prochain projet.
Quand j’ai débarqué dans le Midwest pour enseigner à l’Université du Michigan en 2009, mon lit était déjà plus qu’un simple meuble: c’était mon cocon, mon poste de travail et mon meilleur allié contre le froid et les jours sombres. Avec des hivers glacials qui me rappelaient constamment que 45 degrés – non, pas Celsius, mais l’angle de la pente que je dévalais pour aller travailler – étaient tout sauf agréables, mon lit était devenu une évidence.
Mon appartement, un ancien pensionnat pour jeunes filles de Manhattan, avait été repeint dans des tons éclatants par ma prédécesseure, histoire d’égayer le ciel gris du Michigan. Et devinez quoi? Les murs roses ont fait leur retour, comme une signature. C’est dans cet appartement que, après la fin de la guerre civile au Sri Lanka, je passais mes nuits à échanger avec des correspondants du monde entier, fascinée par l’histoire et la politique de ce pays. Mes nuits devenaient des marathons d’insomnie, non pas à cause du stress, mais par soif d’apprendre. C’était une période intense: j’écrivais, je lisais, je réfléchissais, toujours enroulée dans mon cocon rose.
Quand je me suis installée à Minneapolis en 2015, mon lit a continué d’être cet espace rassurant, un refuge dans un monde qui devenait de plus en plus chaotique. Pendant les soulèvements qui ont secoué la ville après le meurtre de George Floyd en 2020, je suis restée chez moi, immunodéprimée, frustrée de ne pas pouvoir rejoindre les manifestations avec mes proches. Mes mains, fragilisées par de vieilles blessures, m’ont obligée à troquer mon clavier contre la reconnaissance vocale. Assise dans mon lit, je dictais à mon ordinateur les pages de Brotherless Night (2023), mon deuxième roman. À l’extérieur, la ville grondait de colère et de changement, tandis qu’à l’intérieur, je replongeais dans l’histoire violente des pogroms anti-tamouls de 1983 au Sri Lanka. Mon lit était une bulle, un espace entre deux mondes : celui que j’écrivais et celui que je vivais.
Aujourd’hui encore, mon lit reste mon repère, un espace de travail et de réconfort où les idées naissent et les phrases s’assemblent. Il n’a pas besoin de ressembler à un bureau, ni même de faire semblant : un pyjama ou un survêtement suffit. Mais il y a quelques années, j’ai fait une découverte qui a changé ma vie d’écrivain casanier: un lit king size qui se plie et se module, comme s’il m’enlaçait. Il soutient ma tête, soulève mes jambes dans une position digne de l’apesanteur, et m’offre un cocon encore plus parfait pour travailler. C’est un peu comme si mon lit était devenu mon éditeur, un allié qui m’enveloppe et m’aide à affronter le monde – immense et imprévisible – depuis mon sanctuaire. Parce qu’au fond, tant que je peux travailler depuis mon lit, je peux tout gérer.
Autrice: VV Ganeshananthan
Cet article a été traduit en français et adapté pour la Suisse après avoir initialement été publié sur elle.com/uk. Retrouvez tous les autres articles de cette édition sur le site web officiel.