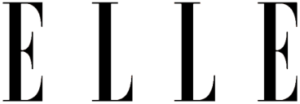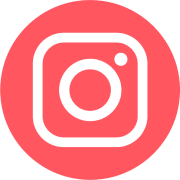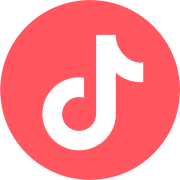« La responsabilité de la mère est de 0 % »: deux journalistes déstigmatisent la fausse couche dans une expo
Continuum de leur premier succès littéraire, Cléa Favre et Kalina Anguelova ont décidé de poursuivre leur collaboration en proposant dès l’été 2024, à Morges, une exposition dépeignant le sujet encore tabou de la grossesse interrompue. Entretien avec Cléa Favre, qui en a été victime à plusieurs reprises, et veut en briser les stigmates.

Plus d’une femme sur quatre subit une fausse couche au cours de sa vie. Une situation plus que concernante que la société estime pourtant encore n’être que de l’ordre du secret à garder chez soi. C’est en ce sens que voyait le jour en 2022 Ce sera pour la prochaine fois. L’œuvre rédigée par Cléa Favre est un cri de soutien envers son propre vécu et les personnes ayant partagé la même expérience. Un livre tripartite qui réunissait non seulement son témoignage, mais également des analyses d’experts ainsi que les illustrations saisissantes de Kalina Anguelova.

Ces dernières font d’ailleurs désormais l’objet d’un second projet. Car si le roman a connu un succès retentissant auprès des plus concernées, les deux anciennes journalistes du Matin estiment que bien du travail reste à faire. Leur but? Parler au plus grand nombre. D’où la mise en place d’une exposition qui sera visible dès le mois d’août 2024, à l’Espace 81 à Morges (VD). Mais pourquoi ne pas pouvoir en parler plus librement? Pourquoi tant de silence autour du début de grossesse? Dans l’attente de l’exposition qui démarre tout juste sa réalisation, Cléa Favre a répondu à nos questions.
ELLE: Le livre Ce sera pour la prochaine fois (2022) a été un succès. Parmi les messages reçus des lecteurs, lesquels vous ont le plus frappée?
Cléa Favre: Kalina Anguelova et moi avons reçu énormément de témoignages de femmes qui se sont enfin considérées comme légitimes à ressentir leur douleur, après la lecture du livre. Parmi ces partages très touchants, il y a eu celui d’une femme âgée s’étant rendue à l’une de nos séances de dédicaces. Emue, elle nous avait alors confiée s’être « autorisée à pleurer pour la première fois », près de 40 ans après sa grossesse arrêtée.
Quel a été l’élément déclencheur vous amenant Kalina Anguelova et vous à, deux ans plus tard, exposer les illustrations de ce livre?
C’est l’écho médiatique qu’a rencontré notre livre. Cela nous a permis de réaliser que la société semblait désormais prête à écouter. Or, un livre ne suffit pas à changer notre regard sur les grossesses arrêtées. D’où ce deuxième projet.
Nous voulons toucher un public plus large que les personnes qui ont vécu une grossesse arrêtée, car l’entourage a un rôle clé à jouer dans l’accompagnement.
Ce livre justement tend à informer de trois manières différentes: à travers le témoignage, les commentaires d’experts, mais également des illustrations qui s’apprécient telles des bandes dessinées. Pourquoi avoir fait le choix d’ajouter cette forme d’expression artistique?
Il y a un grand malentendu lié aux grossesses arrêtées: de l’extérieur, on a l’impression que ce n’est pas si grave. On a du mal à se mettre à la place des femmes qui vivent une grossesse arrêtée. Les illustrations permettent de se plonger dans cette expérience. Par ailleurs, elles sont très complémentaires: quand le texte est trash, elles apportent de la douceur et inversement.
Les illustrations sont en effet très parlantes: parmi les symboliques fortes de l’expérience de la grossesse arrêtée, apparaît la dépersonnalisation du corps médical…
Tout à fait. Il y a heureusement des gynécologues qui ont la sensibilité nécessaire pour accompagner les personnes qui vivent une grossesse arrêtée. Il demeure toutefois encore trop de mauvaises expériences où on ne parle que « d’expulsion du produit […] d’amas de cellules ». Représenter les gynécologues et les infirmier.e.s par des blouses tenues par un cintre dans le livre permettait de souligner la solitude de la femme. On accorde encore peu d’importance à son émotion.
L’enfant que le personnage principal perd est également dépersonnalisé. A plusieurs reprises, il est décrit comme « un truc », « une forme », « un mini-zombie », « un déchet », « une chose »… Comment vous l’expliquez?
D’une seconde à l’autre, on passe de: « Je porte la vie » à « je porte la mort ».
On se sent trahie par son corps. Il y a donc une mise à distance qui débute pour tenter d’intégrer la nouvelle: « Notre bébé ne grandira pas ». C’est en tout cas comme ça que je l’ai vécu. Toutes les femmes et tous les couples le vivent, bien sûr, différemment.
Etonnamment, alors que le sujet est lourd, dramatique, les illustrations revêtent certaines pointes d’ironie. A quelles fins?
Tout d’abord parce que l’ironie est présente dans l’expérience même de la grossesse arrêtée: évidemment, c’est quand on perd son bébé, que l’on n’a jamais croisé autant de femmes enceintes. Avec Kalina Anguelova, l’illustratrice, nous tenions à ne pas raconter une histoire glamourisée des grossesses arrêtées, mais de montrer la réalité telle que je l’ai vécue: abrupte, violente, sans faire non plus dans le sensationnalisme.
Il y a plusieurs mots dont le personnage principal remet en question l’étymologie: la « fausse couche », les « non parents » ou encore les « sans enfants ». Que leur reproche-t-elle?
Le terme « fausse couche » sous-entend qu’une erreur a été commise, ce qui contribue à la culpabilisation de la femme qui était responsable de cette vie. Mais cela renvoie aussi à l’idée que ce n’était pas un vrai bébé, et donc que ce n’est pas un vrai deuil.
Par ailleurs, on nomme les personnes « sans-enfant », aussi dit les « non parents », uniquement par rapport à un vide, une absence. Comme si on ne pouvait pas être une personne complète lorsque l’on s’éloigne de la norme.
Pourquoi était-ce important d’intégrer à votre texte et les illustrations de Kalina Anguelova des interventions d’experts dans le sujet?
Il y a une méconnaissance considérable sur les grossesses arrêtées et beaucoup de fausses croyances. Résultat: des commentaires minimisants et culpabilisants de la part de l’entourage qui font tout sauf du bien. Il était par exemple important pour nous de marteler ce message: la responsabilité de la mère est de 0%.
L’exposition gardera-t-elle ce pan informatif?
Absolument. L’exposition gardera ces trois dimensions: information, émotion et art. Nous avons envie que le public puisse se mettre dans la peau d’une personne qui traverse cette expérience pour qu’il puisse mieux comprendre.
Pourquoi avoir choisi de financer ce nouveau projet à travers un crowdfunding?
Les grossesses arrêtées sont encore très souvent considérées comme un sujet repoussoir ou négligeable. A ce stade, nos demandes de subventions ont été refusées. C’est pour ça que l’on a pensé au financement participatif. Nous avons d’ailleurs reçu beaucoup plus que ce qu’on demandait pour pouvoir réaliser l’exposition, avec par ailleurs de nombreux messages de soutien. C’est une agréable surprise qui nous booste chaque jour et, à titre personnel, ça me permet de mettre du sens dans une expérience qui n’en avait aucun.
Qu’est-ce que la Suisse pourrait davantage faire pour aider les femmes dans les grossesses arrêtées? Vous déclariez dans un entretien que la question était « éminemment politique » …
Oui, c’est politique. Parce qu’en Suisse, par exemple, les frais médicaux liés aux grossesses arrêtées qui interviennent au premier trimestre sont à la charge de la patiente. Mais à partir de 13 semaines de grossesse, tout est pris en charge par l’assurance de base. Quelque part, le message renvoyé à celles qui ne parviennent pas à procréer est que cela n’intéresse pas la collectivité, elles n’ont donc qu’à se débrouiller.
Comme bien d’autres problématiques dites féminines, on a l’impression que cela relève de l’intime, de la sphère personnelle, alors que la société joue un rôle dans la façon dont tout cela est perçu, et donc dans la manière dont on le vit.
Quelles sont vos attentes avec cette exposition?
Nous sommes deux journalistes. Ce sera notre toute première exposition. Nous sortons de notre zone de confort et nous allons beaucoup apprendre. Nous espérons être à la hauteur.