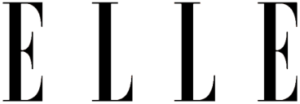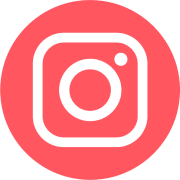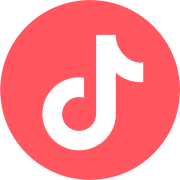L’histoire derrière le bronzage devenu un symbole de statut social

Cela revêt des connotations sociales profondes qui ont évolué et se sont formées au fil des siècles, mais peut aussi témoigner du niveau de pouvoir d’achat, des standards de beauté en mutation, ou même de préoccupations pour la santé. Analyse.
Aujourd’hui, arborer un teint bronzé est devenu un symbole éclatant de santé, de réussite et de loisirs insouciants. Il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Se dorer volontairement au soleil est une tendance relativement récente. Le débat entre la peau claire et la peau foncée comme marqueurs de statut social est une question qui a traversé les âges et les civilisations. Pour en saisir toute la portée, il suffit de se tourner vers la Grèce antique, et l’on comprendra que cette évolution trouve ses racines dans un passé lointain et complexe.
Réussite sociale
Les idéaux de beauté féminine ont traversé les siècles avec une constance remarquable. Dans la Grèce antique, ces idéaux étaient bien définis: la féminité se traduisait par la délicatesse, la pureté et l’innocence. La blancheur de la peau était le reflet de ces vertus et également le signe d’une noble lignée, symbole de statut social et de réussite. Pour atteindre ce teint pâle tant convoité, les Grecques et les Romaines utilisaient du carbonate de plomb, une substance dont nous savons aujourd’hui qu’elle est hautement toxique et potentiellement mortelle.
À la fin du Moyen Âge et pendant la Renaissance, l’idéal de beauté féminine évolua vers un modèle élisabéthain de peau pâle et délicate, rehaussée de lèvres et de joues roses. La reine Elizabeth I d’Angleterre incarnait parfaitement cet idéal, appliquant constamment des cosmétiques pour blanchir sa peau, notamment la céruse vénitienne, un mélange d’eau, de vinaigre et de plomb. Ce produit était prisé par les femmes de la haute société, désireuses de distinguer leur rang.

La peau claire, exempte de toute imperfection, était aussi un indicateur de bonne santé, de fertilité et de prospérité, dans une époque où les ressources médicales étaient limitées. Elizabeth I, ayant survécu à la variole qui avait marqué son visage, utilisait ce cosmétique toxique pour masquer les cicatrices et maintenir son image de beauté immaculée. Une démarche qui visait à non seulement souligner sa beauté, mais aussi sa vigueur, prouvant ainsi qu’elle était apte à régner sur un royaume stable et puissant. Une peau marquée aurait pu être perçue comme un signe de faiblesse, reflétant une image d’instabilité pour son royaume.
Au milieu du 19e siècle en Angleterre, la révolution industrielle provoqua un bouleversement profond dans la société. De nombreux paysans quittèrent la campagne pour s’installer en ville, attirés par les emplois en usine. En conséquence, ces travailleurs passaient désormais la majorité de leur temps à l’intérieur, perdant ainsi leur teint hâlé, tandis que leur statut social évoluait. À cette époque, seuls les membres des classes supérieures pouvaient se permettre de passer du temps à l’extérieur, exposés au soleil. Ainsi, ceux qui arboraient une peau bronzée le faisaient avec fierté, affichant leur position privilégiée.
Mais cette tendance ne fut pas durable. Bientôt, la peau foncée redeviendrait dévalorisée et sous-estimée dans l’échelle sociale. La société de cette époque prônait un idéal de peau de porcelaine. Les femmes se protégeaient du soleil avec des parapluies, des parasols et de grands chapeaux. Ce retour à la peau claire symbolisait une fois de plus la supériorité de ceux qui n’avaient pas besoin de travailler à l’extérieur.
Vacances éternelles
Le 20e siècle marqua un tournant. À la surprise générale, le domaine médical commença à vanter les bienfaits du soleil pour la santé, notamment pour le renforcement des os. Le soleil et la peau bronzée commencèrent alors à être perçus sous un jour plus positif, un changement accéléré par l’influence de Coco Chanel. Considérée comme la première véritable influenceuse, tout ce qu’elle portait ou adoptait devenait tendance. Dans les années 1920, après des vacances sur la Côte d’Azur, la célèbre couturière française revint avec une peau dorée par le soleil, ayant trop bronzé. Ce nouvel aspect fit sensation. Les bains de soleil devinrent rapidement à la mode, symboles de chic et de santé, grâce aux avancées médicales de l’époque. Ses clientes, autrefois adeptes d’une peau blanche et impeccable, se mirent à aspirer à une peau bronzée, reflet d’un nouveau standard de beauté et de bien-être.

Cette période se caractérise également par une plus grande accessibilité aux voyages, l’instauration des congés payés et l’essor du sport. Entre les années 1920 et 1990, à l’exception des années de guerre, le bronzage devient un attribut désiré, voire envié. Arborer une peau hâlée signifiait que l’on avait eu le privilège de profiter de vacances au soleil. Qui n’en rêverait pas?
A lire aussi: Pourquoi Chanel haïssait Dior? La véritable histoire de leur rivalité
C’est durant cette époque que les premiers produits solaires voient le jour. Coco Chanel joue un rôle pionnier en lançant l’Huile Tan, un produit qui, selon elle, « bronze la peau et protège des coups de soleil ». La prochaine avancée viendra de Jean Patou avec l’Huile de Chaldée, une huile de bronzage. Toutefois, ces produits restent coûteux et s’inscrivent dans une idée de bronzage exclusif et prestigieux. Il faudra attendre quelques années pour qu’un produit plus abordable, l’Ambre Solaire, commence à démocratiser ce secteur. Cet autobronzant avec filtre solaire rend le bronzage accessible à une plus large audience.
En 1953, la publicité la plus emblématique pour une crème solaire voit le jour: celle de Coppertone. Elle promeut l’idée que toute la famille peut bronzer, étendant ainsi cette pratique à l’ensemble de la société et non plus seulement aux privilégiés. Cette période post-Seconde Guerre mondiale normalise les voyages vers des destinations ensoleillées pour le plaisir, et les médecins commencent à recommander les sports de plein air et les bains de soleil pour leurs bienfaits sur la santé.
D’autre part, le bronzage se standardise également avec l’arrivée de la photographie couleur et du Technicolor dans les films. Les grandes stars d’Hollywood, arborant une peau bronzée, établissent un idéal de beauté ambitieux que tout le monde souhaite atteindre. Bien que le débat autour du concept de SPF ait débuté en 1962, la société reste sourde à ces avertissements. Le soleil pouvait brûler, certes, mais afficher un teint hâlé en valait la peine. Dans les années 1970, Coppertone introduit les premiers produits autobronzants, destinés à ceux qui ne pouvaient pas voyager ou qui vivaient dans des régions peu ensoleillées. Pendant cette période, Mattel lance la poupée Malibu Barbie, équipée de lunettes de soleil et de crème solaire, symbolisant cette tendance.
Les années 1980 et 1990 marquent l’apogée du bronzage. Tout le monde aspire à paraître « baigné de soleil ». Le teint hâlé devient un signe de réussite, non seulement sur le plan personnel mais aussi professionnel. Avoir la peau pâle n’est plus valorisé. Pour répondre à cette demande, les rayons UVA nocifs sont commercialisés en masse, rencontrant un succès retentissant. Personne ne manque son rendez-vous avec le bronzage. Le maquillage s’adapte également, intégrant des poudres bronzantes dans les routines de beauté. Les poudres Terracotta de Guerlain, devenues une référence en cosmétique, sont l’exemple parfait de cette tendance durable.
Cette époque est marquée par des images célèbres qui perdurent encore aujourd’hui. Des personnalités comme Julio Iglesias, arborant un bronzage constant et intense, en font même leur marque de fabrique. Les soirées emblématiques de Marbella voient les élites de la société exhiber leur peau foncée, tandis que les tapis rouges du début des années 2000 présentent des célébrités comme Jennifer Lopez et Cameron Diaz portant fièrement les marques de bikini. Le bronzage devient alors un synonyme incontestable de statut économique et de notoriété, une tendance omniprésente.

Conscience des dangers
Une période que de plus en plus de spécialistes finissent par lier à de l’irresponsabilité généralisée face aux dangers du soleil. C’est un tournant dans le siècle, une prise de conscience accrue des risques associés à l’exposition solaire apparaît. Cette nouvelle réalité entraîne une peur et une stigmatisation du soleil, marquant un changement radical dans les attitudes envers le bronzage.
Les taches cutanées, les carcinomes, les mélanomes… Ces termes deviennent de plus en plus familiers alors que la société prend conscience des dangers du soleil et de l’importance d’une protection solaire adéquate. Les produits solaires évoluent, passant de simples produits pour le « bronzage » à des « crèmes solaires » mettant l’accent sur la protection. Ainsi, l’obsession pour le teint bronzé diminue et la priorité devient la santé de la peau. Pour obtenir un hâle, les gens se tournent vers les autobronzants ou prennent des bains de soleil avec précaution et protection.
Mais la tendance connaît un renouveau avec l’avènement de la pandémie de Covid-19. Les confinements ont bouleversé nos vies de manière inattendue, ravivant le désir de profiter du plein air et du soleil. Néanmoins, cette fois-ci, la quête du bronzage se teinte d’une conscience accrue de la santé. Le désir d’avoir une peau bronzée, synonyme de santé et de beauté, s’exprime désormais particulièrement sur les réseaux sociaux, où des plateformes comme TikTok sont le foyer de tendances éphémères. On y voit des utilisateurs recréer l’effet du « bain de soleil » à l’aide de maquillage, adopter le « maquillage latte » pour un teint doré, ou appliquer du blush pour un effet « coup de soleil ». Des astuces farfelues comme l’utilisation de brocoli pour simuler des taches de rousseur ne sont pas rares. Chaque mois, de nouvelles tendances émergent, témoignant de l’engouement persistant pour le bronzage.
Cependant, cette passion renouvelée pour le teint hâlé s’accompagne désormais d’une conscience accrue de l’importance de la protection solaire. Nous sommes plus conscients des dommages potentiels du soleil sur la peau et utilisons davantage de produits de protection solaire.
Retour au naturel
Pour Victoria Oliver, responsable des relations publiques et de la communication chez Saint-Tropez, leader des produits autobronzants, le regain d’intérêt pour le bronzage et l’essor de l’utilisation des autobronzants reflètent une évolution de la conscience de la santé, des influences et des normes culturelles. D’un côté, les campagnes de sensibilisation au cancer de la peau mettent en avant les risques liés à l’exposition au soleil et encouragent des comportements plus sûrs. D’un autre côté, les célébrités et les influenceurs ont popularisé l’esthétique bronzée et le « look no make-up », favorisant une apparence plus naturelle. La culture du bien-être met également l’accent sur la santé générale, y compris les soins de la peau, ce qui conduit à rechercher un teint hâlé tout en préservant la santé et la beauté de la peau.
En effet, ces dernières années, le domaine de la beauté a considérablement évolué. Autrefois, les produits de maquillage étaient principalement utilisés pour « cacher » les imperfections et paraître plus beaux. Aujourd’hui, l’idée de prendre soin de la peau pour éviter ces imperfections est de plus en plus préconisée. La tendance est au naturel et à l’acceptation de soi, en mettant en valeur nos particularités et en traitant notre peau avec bienveillance. Il s’agit de trouver des produits respectueux de la peau, de la protéger et de la chouchouter. Nous ne cherchons plus à avoir un teint foncé au détriment de notre santé, mais à être beaux et hâlés de manière responsable. Ainsi, selon Victoria Oliver, « l’envie de bronzer et la perception de l’attractivité ont toujours été liées, mais à mesure que la peau et la beauté deviennent encore plus liées, l’autobronzant devient plus pertinent, car il sert de pont entre les deux ».
Confiance en soi
Bien sûr, le bronzage, même lorsqu’il est obtenu de manière plus sûre grâce à l’autobronzant, revêt des dimensions sociales, psychologiques et économiques. Comme l’explique Victoria Oliver, aujourd’hui, le teint hâlé reste associé aux idéaux d’accès aux loisirs, de bien-être et de richesse, non seulement en raison du statut social qu’il confère, mais aussi en raison de ses effets réels sur la peau. L’autobronzant n’est plus considéré comme un simple substitut au bronzage naturel, mais comme un outil pour combler le fossé entre les soins de la peau et la beauté, en améliorant la texture de la peau, en offrant une alternative au maquillage et en procurant des bienfaits pour la peau.
D’un point de vue psychologique, il est important de considérer l’impact sur l’image de soi, un aspect qui revêt une importance particulière de nos jours. Prendre soin de soi, se sentir beau ou belle, et par conséquent, être confiant, contribue grandement à notre bien-être mental. C’est un acte d’amour-propre, réalisé pour soi-même plutôt que pour les autres. Comme le souligne la responsable communication de Saint-Tropez, les individus qui bronzent ont tendance à se sentir plus confiants et attirants avec un teint hâlé, cherchant ainsi à incarner leur meilleure version, glamour et impeccable, non seulement pour se sentir bien dans leur peau, mais aussi pour projeter une image qui reflète cette confiance et cet éclat.
L’une des raisons pour lesquelles les gens se tournent vers l’autobronzant plutôt que les salons de bronzage est le coût. « En fait, nous avons remarqué que 34 % des Britanniques ont réduit leurs visites dans les spas et les salons de beauté au cours des trois derniers mois. Comparé à l’utilisation des lits de bronzage, il y a de nombreux avantages, y compris des risques pour la santé, car il s’agit d’une alternative beaucoup plus sûre », explique Victoria Oliver. Avec l’amélioration constante des formules des autobronzants, qui permettent d’obtenir un bronzage parfait tout en traitant des problèmes esthétiques tels que les vergetures ou la cellulite, de plus en plus de consommateurs se tournent vers ces produits. Ils peuvent ainsi prendre soin de divers aspects de leur peau depuis le confort de leur foyer.
En ce qui concerne la saisonnalité du bronzage, cela varie selon les cultures et les régions. Dans certains marchés où le bronzage est profondément enraciné dans la culture, l’achat d’autobronzants est constant tout au long de l’année. C’est le cas notamment en Espagne et au Portugal, où le bronzage est souvent présent de janvier à décembre, en contraste avec d’autres pays comme le Danemark. Cependant, dans les pays où l’ensoleillement est plus limité et se concentre principalement en été, la saisonnalité est plus marquée. Dans ces régions, la haute saison du bronzage se situe en été, en raison des conditions météorologiques et des habitudes de bronzage saisonnières. Comme le souligne Victoria Oliver, « sur les marchés où le bronzage est plus récent, la saison haute se situe en été. Cela peut également être dû aux conditions météorologiques qui affectent certains pays, où il est moins courant de chercher à bronzer en hiver, car les gens ont tendance à le faire uniquement lorsqu’ils sont exposés au soleil ».
Autrice: Carolina Cañoto
Cet article a été traduit en français et adapté pour la Suisse après avoir initialement été publié sur elle.com.es. Retrouvez tous les autres articles de cette édition sur le site web officiel.