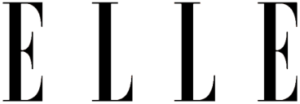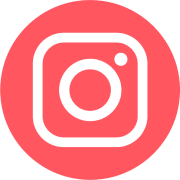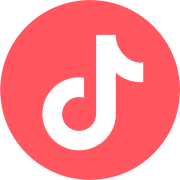Jennifer a 29 ans, un témoignage choc
Elle est infirmière depuis six ans au service infectiologie des Hôpitaux Universitaires de Genève. A l’heure où le monde entier se bat contre le Covid-19, comme des millions d’autres blouses blanches, Jennifer est en première ligne, pour soigner les malades.
La première question qu’on a envie de vous poser c’est «comment ça va»?
Pour le moment ça va… il y a du travail, nos journées sont intenses mais nous ne sommes pas encore surchargés. Nous sommes confrontés à des situations complexes, qui parfois dégringolent très vite, donc il nous faut réagir avec urgence, mais ça va.
Si vous deviez expliquer le coronavirus à un enfant de 5 ans, qu’est-ce que vous diriez?
Il se trouve que j’ai un neveu de 5 ans… Je lui ai dit que c’est un petit virus qui vient de Chine, qui entre dans les poumons des gens et qui rend leur respiration difficile. Donc comme il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui se serrent la main, qui se font des câlins, qui prennent le même bus, qui touchent les mêmes choses, etc…, le virus a beaucoup voyagé autour de la planète et que beaucoup de gens sont tombés malades. Et c’est pour cela que nous devons faire attention et rester chez soi, pour se protéger et protéger les autres de ce méchant virus.
Vous êtes infirmière depuis sept ans. Est-ce que votre quotidien professionnel a changé avec le coronavirus?
Mes horaires sont les mêmes, la charge de travail est juste plus conséquente… Mais je ne pense pas que notre travail ait fondamentalement changé, sauf que là, il n’y a qu’un seul et même sujet dans notre service depuis un mois: le coronavirus.
Les patients ont tous les âges, viennent à différents degrés de sévérité, en comorbidité (association de deux maladies chez une personne qui la rend plus fragile) ou non, il y a des patients qui sont déjà fragiles face à la maladie parce qu’ils sont âgés, d’autres qui ne le sont pas mais qui sont touchés quand même. On doit avancer chaque jour avec un virus qu’on ne maîtrise pas. Personne n’a suffisamment de recul pour savoir, et on est tous à essayer des choses et à s’adapter constamment. Heureusement, on a aussi des patients qui sont sortis, rentrés chez eux et qui vont cliniquement bien.
Les visites aux malades sont interdites… est-ce que ça signifie que vous jouez aussi un rôle d’accompagnement psychologique?
Nous faisons tout pour empêcher la propagation du virus. Donc le lien avec les familles se fait par un appel vidéo, pour éviter les visites.
Il y a beaucoup de patients très inquiets et très apeurés. J’essaie de prendre du temps pour discuter avec eux, être encore plus disponible pour eux, pour leur apporter un réconfort et échanger sur autre chose que de la maladie…
Et puis, un médecin de notre unité a pris une belle initiative qui apporte un peu de réconfort aux patients, mais pas que… c’est la mise en place d’envois de dessins d’enfants que l’on colle sur les murs pour égayer les chambres, les couloirs du service… et ça fait du bien! colorehopital@gmail.com
Qu’est-ce qui est le plus difficile dans cette période?
Pour moi c’est de savoir qu’à tout moment, d’une seconde à l’autre, une situation peut «décompenser», qu’elle peut se péjorer d’un point de vue respiratoire et que le patient va devoir exiger les soins intensifs et une prise en charge différente dans l’urgence. Nous sommes plus sur le qui-vive que la normale.
Est-ce que vous pensez que le système médical suisse était prêt à vivre cette pandémie?
Je pense qu’on n’est jamais prêt à ça, même en imaginant le pire, on n’a jamais envie de le vivre. Mais je pense aussi que la Suisse a vite réagi, qu’elle a été efficace très vite et qu’elle a les moyens matériels, médicaux, humains et les compétences pour faire face.
Est-ce que les HUG ont déjà fait appel à une réserve sanitaire?
Ils mobilisent toutes les forces possibles oui, pour être suffisamment nombreux et efficaces; pour l’instant on n’est pas sous l’eau… On reçoit même des patients de l’étranger pour aider les hôpitaux qui sont submergés.
On parle beaucoup du très lourd tribut payé par le personnel médical, à cause du manque de ressources pour bien soigner les malades (masques FFP2, blouses, gants, lunettes). Est-ce que la Suisse fait face aux mêmes tensions que le reste du monde à ce niveau-là?
J’ai la chance d’avoir toujours pu me protéger dans mon travail. Je ne suis jamais intervenue auprès d’un patient sans être «équipée». On a le matériel, on fait attention à ne pas le gâcher parce qu’on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on a ce qu’il faut.
Alors comment fait-on lorsqu’on est, comme vous, en première ligne, pour se protéger justement?
On porte un masque dès qu’on entre dans le service, qu’on garde constamment sur le nez, à part pour manger ou boire. Quand on entre dans une chambre, on met des gants, une surblouse et un masque. Et ensuite on a tout un protocole habituel de désinfection… Ça n’est ni plus ni moins que ce que l’on fait déjà pour d’autres maladies infectieuses, si ce n’est que là, on a une certaine pression à se dire «il ne faut pas se louper». Mais je suis habituée à ça depuis que je travaille dans ce service. Pour soigner des patients atteints de tuberculose par exemple, je porte aussi un masque FFP2…
On sait et on voit par ailleurs que tous les pays ne se protègent pas de la même manière, certains utilisent notamment des combinaisons intégrales. Au départ, le fait de ne rien avoir en plus que d’habitude m’a un peu inquiétée… Mais ça fait maintenant un mois que nous faisons face au virus tous les jours, et je constate qu’il n’a pas d’hécatombe dans mon service donc c’est la preuve que nous sommes suffisamment protégés!
Est-ce que vous avez peur d’attraper le virus?
Au tout début, je n’avais pas du tout peur parce que comme beaucoup je pensais que ça n’était qu’une grippe. Et puis tout à coup, j’ai vu des patients de tout âge, déjà malades ou non, arriver dans le service puis passer aux soins intensifs parce qu’ils étaient en détresse respiratoire, être intubés, plongés dans le coma pour mettre le corps au repos et je me suis rendue compte que ça pouvait être moi, ça pouvait être n’importe qui en fait. J’avais cette réalité sous les yeux. Ce sont des situations très précaires… et le fait de ne pas savoir où on va, de n’avoir aucune certitude, c’est ça qui est angoissant.
Au niveau physique, comment faites-vous pour tenir? Est-ce que vous vous protégez aussi psychologiquement?
Je me repose plus dès que je le peux ça c’est certain, je sens que mon corps en a besoin.
Au niveau psychologique, c’est assez complexe. Il y a ce que l’on vit, on fait un métier humain, on est face à nos émotions, là encore plus que d’habitude, donc il y a des journées plus difficiles que d’autres. Il y a ce que l’on regarde à la télévision où les médias souvent exagèrent par un phénomène de rabâchage permanent… Il y a ce que l’on voit sur les réseaux sociaux: des gens qui s’improvisent médecins, virologues, spécialistes, avec des commentaires délirants… c’est plus anxiogène qu’autre chose! Alors j’ai dû apprendre à me déconnecter parce que ça devenait trop lourd à supporter. Et ça a été salutaire.
Et puis il y a ma famille et mes amis qui m’envoient des messages, où je ressens leur stress, les interrogations, leurs inquiétudes… C’est ambivalent, parce que je suis touchée qu’ils me soutiennent, et à la fois ça m’embête de leur générer du stress et de leur imposer la gravité de la situation. Il y a aussi des gens qui agissent avec moi comme si j’étais une pestiférée. Ils utilisent l’humour pour me dire qu’ils ne veulent pas me voir parce qu’ils pensent que je suis porteuse du virus. C’est blessant.
Et enfin il y a une sorte de solidarité très précieuse qui est née naturellement au sein du même service, avec des collègues à qui on n’a pas besoin d’expliquer certaines émotions parce qu’ils vivent les mêmes. Alors, on essaie d’être attentifs aux besoins des autres et on est bien volontiers une épaule sur laquelle se poser si l’autre en a besoin.
Qu’est–ce que vous vous dites le matin avant de partir à l’hôpital?
Et le soir en rentrant chez vous?
J’ai choisi ce métier pour aider les gens, les accompagner et essayer de rendre la maladie un peu plus vivable. La situation d’aujourd’hui n’a rien changé à ça, je reste la même et je prends mes patients en charge de la même manière.
J’essaie de ne pas réfléchir, je me dis que je vais faire mon travail comme je le ferais d’habitude, bien qu’il y ait toujours un petit stress qui n’est pas habituel, face à une situation qui l’est encore moins et le fait que l’on ne maîtrise pas ce qu’il va se passer. Je n’ai pas tant peur d’être confrontée à la mort que de ne pas pouvoir venir en aide aux gens…
Comment vous imaginez le jour d’après?
J’espère que les gens resteront bons, je trouve qu’ils sont meilleurs dans leur comportement aujourd’hui; pour la plupart ils font preuve de bienveillance, ils se soucient un peu plus de ceux qu’ils ne se connaissent pas, de leurs proches… J’espère que ce sentiment bienveillant et solidaire restera, et que l’on saura tirer du positif de cette épreuve commune.
Tous les soirs, les Suisses sont à leurs fenêtres pour applaudir le personnel soignant et saluer leur dévouement. C’est devenu un rituel dans beaucoup de pays. On imagine que cela vous touche? Qu’est-ce que vous avez envie de dire?
Déjà, j’ai envie de leur dire merci. Mais on fait avant tout notre travail, celui qu’on faisait avant le coronavirus et qu’on fera après le coronavirus. Mais j’ai aussi et surtout envie de leur dire que la meilleure façon de nous aider, c’est de ne pas sortir, de ne pas aller faire les courses tous les jours, de ne pas aller se balader au bord au lac… J’ai envie de dire aux gens qui se plaignent de «devoir rester enfermés», «venez passer une journée avec nous et vous ne vous plaindrez plus!»
Limiter ses déplacements et ses échanges sociaux sont des mesures complémentaires aux applaudissements. Alors restez chez vous!