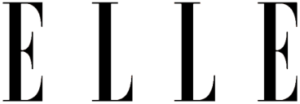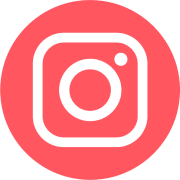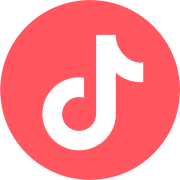Gaël Faye, Prix Renaudot pour Jacaranda (2024): les secrets de son écriture
Après l’immense succès de son premier roman Petit pays (2016), Prix Goncourt des lycéens en 2016, Gaël Faye vient à nouveau d’être distingué par un prestigieux Prix littéraire, – le Renaudot – pour Jacaranda (2024). Nous l’avions rencontré en septembre dernier à Morges lors du Livre sur les quais où il avait créé l’événement alors que son roman venait tout juste de paraître.

ELLE: Votre roman rencontre un formidable accueil des lecteurs. Comment le vivez-vous?
Gaël Faye: C’est incroyable! Je suis porté par cet enthousiasme autour du livre! J’appréhendais énormément sa sortie et je vis un rêve éveillé.
ELLE. Pour quelles raisons écrire à nouveau sur le génocide au Rwanda?
Je travaillais sur un autre roman mais le fait de vivre au Rwanda me place en face de réalités que j’estime assez urgentes. Et en premier lieu, la question de la transmission à la nouvelle génération de ce qui s’est passé ces trente dernières années. 70 % de la population rwandaise est née après le génocide : on doit s’intéresser à la reconstruction, à la manière dont on revit ensemble. Le sujet n’est pas encore vraiment abordé par les romans, à part Ainsi pleurent nos hommes (2022) de Dominique Celis. Cette année 2024 était particulière. On a commémoré les trente ans du génocide des Tutsi et les discussions ont été nourries. La prise de conscience du temps qui passe, de ce que de ce que l’on fait de la mémoire, est importante. La mémoire est un objet mouvant et il faut l’entretenir. C’est pour cette raison que j’ai créé ce personnage central, cette petite fille qui est en haut de son arbre. Elle est le dernier échelon de l’arbre de la société, qui regarde loin et qui, dans le même temps, a besoin de cet ancrage.
La mémoire est un objet mouvant et il faut l’entretenir.
Vous dites avoir arrêté l’écriture d’un autre roman au moment où Jacaranda s’est imposé à vous. Pourriez-vous la reprendre?
Ce n’est pas certain. Je me rends compte qu’un roman est la photographie d’un instant. Si l’on me demandait d’écrire Petit pays aujourd’hui, je ne le pourrais pas : je ne suis plus dans l’urgence que je ressentais en 2015. Et c’est pareil avec Jacaranda. Il y avait aussi une urgence. Je me suis dit que je devais l’écrire maintenant parce que la société allait changer, qu’on allait oublier. J’avais besoin de retenir des images qui disparaitront.
Quel a été le déclic pour l’écriture de Jacaranda?
Le personnage de tante Eusébie – qui était déjà dans Petit pays – m’obsédait. On ne savait pas ce qu’elle était devenue. J’ai commencé à écrire de courtes scénettes, une forme de rêverie. Et petit à petit, se sont imposés Stella, Milan, cet arbre…
Que représente pour vous le jacaranda?
Il y a d’abord la symbolique de l’arbre : les racines, les ailes, les fruits… Il représente un repère pour Stella en particulier. Mais au-delà, c’est aussi une espèce de repère stable dont toute société a besoin. On ne peut pas être flottant. Et puis c’est aussi l’émerveillement, la beauté du pays, sa délicatesse. Enfin, il représente le témoin muet : il a tout vu. Il sait, il garde, des secrets. Le Rwanda est un pays d’une beauté confondante. Un génocide ne laisse aucune trace, ce n’est pas une guerre, il n’y a pas des bombardements. Quand je suis au Rwanda face à un jacaranda, je me demande s’il existait quand tout cela est arrivé. Cet arbre représente donc aussi une discussion avec l’invisible. Et puis j’aime beaucoup la sonorité du mot.
Un roman est la photographie d’un instant.
Qui était déjà présente dans certaines de vos chansons d’ailleurs…
Oui, je l’utilise d’ailleurs depuis mes premières chansons parce que ce mot est également lié à des émerveillements de l’enfance. Le jacaranda correspond aussi à une critique du progrès. Il y a la violence du génocide et, en réaction, une société qui va très vite dans sa reconstruction. J’ai aussi pu l’observer aussi dans d’autres communautés qui ont subi des génocides : les générations d’après se lancent parfois corps et âme dans le travail pour ne pas penser à ce qu’elles viennent de traverser. Je ressens presque une pathologie de l’avenir chez certains, une envie de faire table rase de ce qui était là avant.
D’où l’importance d’avoir des récits pour accompagner chacun, prendre le temps.
Un roman, c’est le temps long, l’observation du temps long. C’est un moment de pause aussi, une lecture. C’est ce que j’aime aussi avec les livres, se laisser imprégner par le rythme d’un roman. Ce temps de lecture est aussi tout de même un pied de nez à la modernité, au progrès, à la frénésie de notre vie.
Vos préoccupations apparaissent universelles. Saviez-vous que les écoliers suisses vous lisaient également?
Je viens de l’apprendre! Le Rwanda est une toile de fond mais il s’agit avant tout d’une question d’humanité. On ne dit pas crime contre l’humanité pour rien. La déshumanisation, l’impunité, la désignation d’un bouc émissaire et la façon dont les sociétés se relèvent de l’extrême violence existent aussi ailleurs qu’au Rwanda.
Vous montrez que si la reconstruction est en marche, la réconciliation se révèle plus compliquée…
La paix des cœurs est insoluble car chacun porte son histoire et sa vérité. On voudrait que tous les humains, d’un même élan, aillent dans une seule direction. Mais cela n’existe nulle part. Il n’y a que la littérature pour approcher ce type de vérité.
La paix des cœurs est insoluble car chacun porte son histoire et sa vérité.
Le procédé de narration que vous avez mis en place avec plusieurs générations de personnages s’est-il imposé immédiatement ?
Il est venu petit à petit en réalité. J’avais d’abord envie de comprendre la logique interne d’un personnage comme Milan, un petit Français qui découvre au hasard de l’actualité qu’il porte en lui une autre histoire ignorée. Il va donc à la rencontre de cette histoire. C’était mon point de départ. Et c’est en cheminant dans l’écriture que peu à peu se sont mis en place les autres personnages. Je voulais également arrêter le roman en 2020. Et j’ai réalisé par la suite à quel point cette année est symbolique. Le président actuel du Rwanda, Paul Kagame, est arrivé au pouvoir en 2000 alors que le pays était encore exsangue. C’était comme si le génocide venait d’avoir lieu. Il a mis en place un programme qu’il a appelé Vision 2020 et promettait que l’économie du Rwanda aurait atteint un niveau intermédiaire d’économie. Il promettait des routes, de l’électricité, Internet partout, de l’eau, une mutuelle de santé universelle… un programme très ambitieux et qui a fait beaucoup jaser : nombreux pensaient que c’était utopique. Mais le programme a marché. Il a donc fait taire les oiseaux de mauvais augure. 2020, c’est aussi l’année du Covid qui a été comme un arrêt du monde. Et j’ai trouvé que la coïncidence entre ces deux dates et ces deux événements constituait une borne intéressante pour dire que c’était la fin de mon histoire.
Au-delà de l’histoire de Milan, votre livre est riche en enseignements, comme pourrait le faire un documentaire, un essai. Pour quelles raisons avoir choisi la forme de la fiction ?
C’est une question toujours délicate : chacun a sa perception du monde. La fiction m’a permis de ne pas rester coincé avec une frustration et même parfois une colère que j’ai pu éprouver à l’adolescence face à des silences pesants, une incapacité à dialoguer, à parler. La fiction me permet d’aller au-delà du mur du silence, de le traverser et d’inventer la porte qui nous fait passer de l’autre côté. C’est une manière e créer ma propre mythologie. Quand la vérité est tue, on a le droit, en tant que en tant qu’humain, de répondre aux questions qu’on se pose.
Pour qui écrivez-vous, Gaël ?
J’écris d’abord pour moi mais aussi pour des gens qui souhaiteraient se sentir moins seuls. Ce n’est pas évident : je suis reconnu en tant qu’artiste, mais quand je repars sur l’écriture d’un livre comme Jacaranda, je dois me remettre dans l’état d’esprit de mes débuts, quand j’écrivais sans qu’il y ait nécessairement d’attente. Il me semble qu’on n’écrit jamais de façon anodine ou innocente. Il y a toujours quelque chose qui nous travaille et sur lequel parfois on ne peut pas mettre de mots. J’écris pour cette raison, entrer en dialogue, être moins seul. Et les retours des permettent aussi que d’autres discussions aient lieu.
Les lecteurs qui viennent vous rencontrer sont-ils différents du public qui assiste à vos concerts ?
Je n’en ai pas l’impression. Beaucoup de lecteurs de Suisse me disent m’avoir vu au Paléo, au Montreux Jazz Festival… Un lien existe entre nous. Ces personnes ont accepté de rentrer dans un univers et cela me touche beaucoup.
La fiction me permet d’aller au-delà du mur du silence, de le traverser et d’inventer la porte qui nous fait passer de l’autre côté.
Abordez-vous l’écriture de vos romans de la même manière qu’une chanson ?
Peut-être pas une chanson, parce qu’une chanson, c’est un petit objet, mais un album, oui. Un album, c’est vraiment un roman. Une chanson, ce serait comme un chapitre d’un roman.
Un nouvel album est-il d’actualité ?
Tout à fait ! J’ai été en studio récemment avec Guillaume Poncelet. On a fait pas mal de compositions et nous y retournerons en fin d’année.
Vous arrive-t-il de vous relire à voix haute pour peut-être entendre la musique de votre texte ?
Cela m’arrive. Mais je me suis rendu compte hier en faisant l’une des premières lectures musicales du livre devant un public, que se lire à voix haute tout seul était très différent. Peut-être que j’embaucherai deux ou trois copains pour m’écouter lire le prochain roman !
Avez-vous écarté certains événements de votre récit ?
Pas vraiment. Mais j’ai atténué les niveaux de violence dans les témoignages : je ne m’en sens pas capable et j’éprouve une forme d’aversion pour un langage qui se voudrait trop cru. J’aurais l’impression d’esthétiser la violence. Il me semble que notre cerveau est suffisamment bien fait pour lire une phrase et faire le travail que la phrase ne fait pas.
Certaines scènes ont-elles été particulièrement éprouvantes à écrire?
Oui, les témoignages sans aucun doute. Celui de Claude, celui d’Eusébie, c’est ce qui a été le plus dur pour moi.
A vos yeux, la vie est-elle toujours la plus forte?
Toujours. Et c’est une bonne nouvelle!