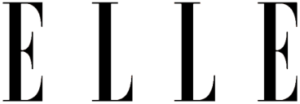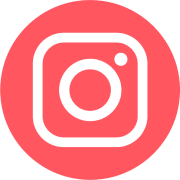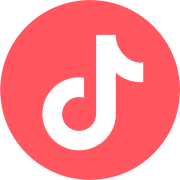« Adolescence » sur Netflix: un uppercut cinématographique à voir absolument
Dévoilé sur la plateforme de streaming jeudi, le dernier thriller psychologique numéro un en Suisse offre une anatomie glaçante des dérives de la masculinité en crise, celle poussant la solitude à commettre l’irréparable. Comment naît cette jeunesse radicalisée dans la réalité? La mini-série parvient-elle réellement à délivrer un miroir fidèle de la société? Analyse.

« Une claque », « une série magistrale », « d’une précision diabolique »: rarement Netflix a fait autant l’unanimité auprès de la critique. C’est certain: 2025 ne fait que débuter et tient peut-être déjà en Adolescence sa mini-série de l’année. Dévoilée sur la plateforme de streaming jeudi 13 mars, le dernier bijou créé par Jack Thorne et Stephen Graham est plus qu’un thriller psychologique. La série propulsée au top du classement de Netflix Suisse est une exploration aussi dérangeante qu’essentielle dans les méandres de l’esprit d’une part toujours plus importante d’hommes et plus jeunes en quête de repères.
L’histoire se concentre sur Jamie Miller (Owen Cooper). Le Britannique est accusé d’avoir tué sa camarade de classe Katie Leonard en la poignardant sauvagement à sept reprises sur un parking. Une accusation qui bouleverse non seulement la vie du jeune garçon de 13 ans, mais aussi celle de sa famille et des membre de son école. Au fil de quatre actes tournés en plans-séquences assurément anxiogènes, le spectateur est plongé dans une enquête qui se meut progressivement en une analyse des conséquences dévastatrices de la « masculinité toxique ». Cette pensée, qui fragmente toujours plus les relations hommes-femmes, est dans la série portée par un nom: celui d’Andrew Tate.

Qui sont les « Jamie Miller » de la réalité
Si Adolescence s’ancre dans la fiction, le nom d’Andrew Tate, lui, n’est nullement issu de l’imaginaire. Cette figure controversée a bâti son empire sur les réseaux sociaux à travers des propos des plus polarisants. Auto-proclamé « masculiniste », cet ancien combattant de kick-boxing défend une conception archaïque des rapports de genre, où l’homme se veut dominant et voit la femme comme sa propriété. Véritables porte-étendards d’un « retour à l’ordre » au sein de la société moderne, ses discours anti-féministes ont surtout trouvé un large écho durant les confinements de Covid-19, dépassant très vite les frontières jusqu’à toucher des milliers de Francophones. Ses versants français devenant de fidèles disciples, puis d’assidus porte-paroles, du raillé Fabrice Lucien au plus intraitable Alex Hitchens.
Leurs terrains de jeu favori? Des plateformes comme YouTube Shorts ou TikTok, où l’algorithme favorise une propagation virale de ces messages. Pauline Ferrari, journaliste ayant enquêté sur le sujet, estime chez Radio France qu’il faudrait « moins de dix minutes » pour faire basculer l’algorithme du réseau social chinois du côté des contenus masculinistes. Elle liste alors des modus operandi répondant aux codes de la plateforme avec des titres accrocheurs tels que « Comment devenir un homme alpha mâle dominant » ou encore « Pourquoi les femmes sont des morceaux de viande ».

Et ces vidéos visent des profils bien distincts, des profils essentiellement comme celui de Jamie Miller. Dans Adolescence, ce dernier n’est pas simplement un adolescent perturbé. C’est un produit d’une culture radicalisée par cette « manosphère », victime d’un cocktail toxique entre l’isolement social, le harcèlement et peut-être encore des parents, bien qu’intentionnés, croyant protéger leur enfant derrière des écrans plutôt qu’en l’intégrant dans la réalité du monde extérieur. Chez Radio France encore, Pauline Ferrari souligne que les influenceurs masculinistes ciblent avant tout ces jeunes, car plus à même d’être touchés par leurs solutions « clé en main » face à des problématiques qui s’avèrent pourtant d’une sérieuse complexité.
Une dynamique que Robert Lawson, professeur en sociolinguistique à l’Université de Birmingham et auteur de l’ouvrage Langage et masculinités médiatisés (2023) dépeint également chez Vox: « Quelqu’un comme Andrew Tate est attirant parce qu’il rassemble les jeunes hommes en leur répétant que leur masculinité est nécessaire pour lutter contre un monde où plus personnes, notamment les femmes, ne dépend d’eux, financièrement ou émotionnellement. […] [Son but] est alors de normaliser la misogynie, en la présentant comme socialement acceptable, voire rationnelle. »
L’occasion manquée d’Adolescence
Loin de se réduire à une analyse du seul Jamie Miller, Adolescence invite à une réflexion plus large sur la place des hommes dans une société que les masculinistes jugent menacée par l’égalité. Mais ce malaise masculin ne doit pas faire oublier une réalité plus vaste: celle d’un monde en mutation, où les rapports de pouvoir changent, mais encore trop souvent aux dépens des femmes. Un paradoxe que soulève la série, mais d’après la rédaction de ELLE, de manière trop éparse.
Si Adolescence se veut un miroir des jeunes hommes en crise, elle tend aussi à un moment à dresser la difficulté de rendre justice à la souffrance des filles et des femmes dans ce récit social. Notamment à travers l’épisode 2 qui évoque la manière dont les victimes féminines sont trop souvent éclipsées par l’attention médiatique ou sociale portée à leurs agresseurs masculins. Sauf qu’Adolescence tombe elle-même dans ce travers: hormis une brève réplique du Sergent Frank (Faye Marsay), la série passe rapidement sur cette réalité. On aurait pu espérer que l’épisode 4, bien trop long par ailleurs, s’en empare davantage pour rééquilibrer la perspective. Mais en concentrant l’intégralité de la narration sur Jamie, la série Netflix réduit Katie à un rôle de victime silencieuse, laissant une fois encore la parole à la personne ayant commis – et non subit – l’irréparable.

Malgré cette lacune, Adolescence demeure une série à voir absolument. Certes, elle ne suffira pas à enrayer l’emprise de l’idéologie masculiniste sur une partie de la jeunesse. Mais ses quatre épisodes plongeant dans les recoins les plus sombres de l’esprit masculin contemporain et de ses enjeux présentent l’indéniable pouvoir d’ouvrir des discussions essentielles autour des dynamiques de genre. Notamment grâce à une mise en scène technique et cinématographique alléchante qui marque pour longtemps.