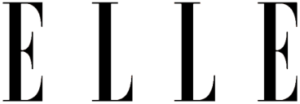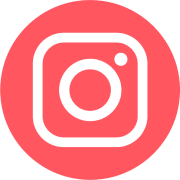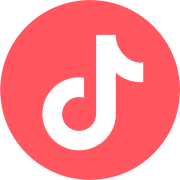Pourquoi tant de Suissesses refusent de se dire féministes ?
C’est un constat qui peut troubler. En Suisse, près de neuf femmes sur dix dénoncent les inégalités. Or, plus de la moitié contestent se revendiquer féministes. C’est l’une des conclusions d’un sondage exclusif commandé par ELLE Suisse auprès de l’institut MIS Trend, à l’aube de la grève nationale du 14 juin. Comment expliquer une telle défiance envers un mouvement pourtant censé les défendre ? Décryptage.

Samedi 14 juin, la grève féministe investira les rues de Suisse. Mais cinq ans après la vague violette historique, qui avait réuni plus d’un demi-million de personnes dans le pays, une question persiste : quel est l’impact réel de cette mobilisation sur la vie des femmes aujourd’hui ? Pour mieux cerner la perception actuelle des inégalités de genre et les formes d’engagement qui en découlent, ELLE Suisse a mandaté l’institut de sondage MIS Trend, leader sur le marché romand, afin de réaliser une enquête exclusive. Conduit du 7 au 18 mai 2025 auprès de 1385 femmes âgées de 18 ans et plus, tous bords politiques confondus, ce sondage trace un paysage helvétique complexe.
Premier constat significatif : une quasi-unanimité. 87 % des femmes interrogées estiment en effet que des inégalités entre les hommes et les femmes sont bel et bien présentes en Suisse. Elles se manifestent avant tout dans le monde professionnel (87 %), puis diffèrent selon les tranches d’âge : pour les 30-44 ans, les principales inégalités entre hommes et femmes s’immiscent dans la vie de couple ou de famille, pour les plus de 60 ans, elles régissent les problématiques liées à la retraite et chez les 18-29 ans, elles dominent l’univers du sport. Pour Ilana Eloit, professeure et spécialiste des théories féministes à l’Université de Genève, ce consensus reflète une période charnière : « C’est l’un des effets directs de la visibilité accrue du féminisme dans l’espace public depuis la vague #MeToo. »
Etiquette encombrante depuis longtemps
Et pourtant, seules 39 % des femmes sondées se disent féministes. Un décalage qui ne surprend pas la chercheuse : « Les réticences à se dire « féministe » peuvent s’expliquer par le fait que le terme renvoie souvent à un militantisme actif ancré à gauche. » Un constat corroboré par l’historienne Marie-Elise Hunyadi, spécialiste des mouvements féministes internationaux, qui ajoute dans ce clivage le fait que « certaines femmes engagées pour défendre les droits des femmes refusent l’étiquette de « féministes » qu’elles considèrent contre-productive pour faire avancer leur cause. »
Ce scepticisme, d’autres chiffres de MIS Trend tendent à le justifier : une femme sur deux en Suisse (54 %) juge le mouvement féministe « trop radical ». Derrière ce « trop », relève Ilana Eloit, se cacheraient cependant des clichés que la sociologue impute à des stéréotypes « proprement misogynes » : « Se revendiquer féministe, c’est prendre le risque d’être perçue comme « trop » – « trop irrationnelle », « trop hystérique » donc pas assez féminine – et alors de perdre en capital séduction dans une société encore largement soumise au regard masculin ». Un poids qui serait d’autant plus lourd à porter pour celles déjà confrontées à des oppressions raciales, transphobes ou de classe, pointe-elle.
C’est ce que souligne tout autant Marie-Elise Hunyadi en positionnant cette ambivalence dans l’Histoire. Elle prends ainsi l’exemple de la FIFDU (Fédération internationale des femmes diplômées des universités) sur laquelle sa thèse s’est concentrée sur la période de 1919 à 1970 : « Ces femmes, très éduquées, militaient pour l’accès à des postes à responsabilité, mais insistaient aussi sur la possibilité de concilier carrières et conservation des rôles de mères et d’épouses. L’une d’elles affirmait même que “l’on peut être savantes et studieuses, mais n’oublions jamais d’être femmes”. »
Une manière en somme de faire avancer la cause sans du moins heurter de front les normes établies. Aujourd’hui encore, cette stratégie d’équilibre semble perdurer, poursuit l’historienne : « Beaucoup de femmes préfèrent démontrer qu’elles peuvent réussir aussi bien (même mieux) que les hommes et ensuite utiliser ces exemples afin de déconstruire la prétendue infériorité des femmes, plutôt que de débattre frontalement et théoriquement. »
Pas un, mais des féminismes
Résultat : seules 22 % des femmes interrogées par ELLE Suisse et MIS trend déclarent avoir déjà participé à la grève féministe. Et elles ne sont que 3 % à envisager se rendre à la prochaine. Outre la mobilisation jugée radicale, les principales raisons évoquées par celles qui n’y participeront pas étant le doute quant à l’efficacité de la grève (17%) ou le manque de temps (12%). Fait notable : certaines de ces critiques sont également formulées par des femmes se revendiquant féministes.
Si l’on peut donc être contre les inégalités et refuser de se dire féministe, peut-on tout autant se dire féministes et ne pas vouloir participer à la mobilisation nationale ? C’est en tout cas ce que soutient Ilana Eloit. Il n’existe, selon elle, pas un seul féminisme, mais plusieurs façons de revendiquer l’égalité, « certains plus réformistes ou institutionnels, d’autres plus offensifs et radicaux ». L’avantage étant que cette variété, conclut-elle, permet au féminisme de pénétrer et produire des changements dans toutes les strates de la société. » Pour autant, la sociologue insiste : « Cette méfiance vis-à-vis du terme reste à combattre : il faut faire entendre que le féminisme est un engagement égalitaire, humaniste et une exigence de justice sociale. C’est un travail de déconstruction toujours d’actualité. »
Marie-Elise Hunyadi ne conteste pas cette analyse. Toutefois, l’autrice de L’accès des femmes aux études universitaires (2024) estime que, dans une société « aussi polarisée », il peut être nécessaire de repenser la manière dont on parle d’égalité. L’historienne et sociologue avance ainsi qu’« en préférant se centrer sur l’égalité entre femmes et hommes, on pourrait apaiser les tensions et rappeler que le féminisme n’est pas qu’un mouvement de femmes. Trouver un terme englobant l’émancipation des deux sexes pourrait fédérer davantage de monde et donc contribuer à une véritable égalité. »