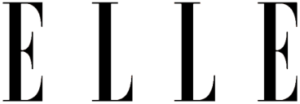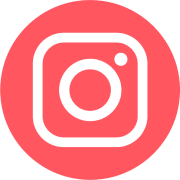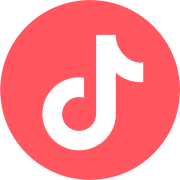« La guerre des Rose », version 2025 : mordante, mais moins féroce que l’original
Olivia Colman et Benedict Cumberbatch s’aiment et se déchirent avec un humour cinglant dans une version moins cruelle du film culte.

Première prise. En 1989, Danny DeVito signait l’excellente adaptation du roman The War of the Roses (La guerre des Rose) de Warren Adler, paru en 1981. Il y incarnait un avocat spécialisé dans le divorce et à jamais marqué par l’histoire de Barbara Rose (Kathleen Turner) et Oliver Rose (Michael Douglas), un couple s’entredéchirant dans une escalade de cruauté jubilatoire pour conserver leur maison. À l’époque, montrer avec autant de cynisme l’implosion d’un mariage était assez inédit dans un Hollywood friand de familles idéalisées.
Deuxième prise. Pour le remake, plus de trente-cinq ans plus tard, trouver qui pouvait succéder au duo Turner-Douglas, dont l’alchimie flamboyante avait déjà habité À la poursuite du diamant vert (1984) et Le Diamant du Nil (1985) avant de sublimer La guerre des Rose (puis de déployer toute sa splendeur en 2019-2020 dans La Méthode Kominsky), relevait presque de l’impossible.
Un film qui s’affranchit du modèle
Dans cette nouvelle version, à voir dès mercredi 27 août dans les salles romandes, Olivia Colman incarne Madame Rose. L’actrice caméléon, reine de The Crown et Oscar de la meilleure actrice pour La Favorite, fait, comme à son habitude, dans l’excellence. Face à elle, son compatriote britannique et ami de longue date Benedict Cumberbatch, irrésistible en Monsieur Rose, confirme qu’il brille autant dans le drame (The Imitation Game, The Power of the Dog) que dans la comédie. Pour leur première réunion à l’écran, leur complicité est évidente, même si elle suscite finalement moins d’étincelles que l’explosive alchimie de Kathleen Turner et Michael Douglas.
Peut-être parce que cette nouvelle mouture ne cherche pas à reproduire la même intensité destructrice. Le cinéma raffole des remakes, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire, mais généralement pour ne rien dire de plus que l’original. Ce n’est pas le cas ici : le réalisateur Jay Roach (Austin Powers, Mon beau-père et moi), qui s’était cassé les dents sur l’affligeant Dinner for Schmucks (remake du Dîner de cons en 2010), réussit son pari en prenant ses distances avec ses modèles.

Plutôt que de livrer un copier-coller dépoussiéré, il réinvente ses personnages – rebaptisés Ivy et Theo Rose – et signe une œuvre autonome, qui tient finalement moins du remake que du clin d’œil au film de DeVito et au roman d’Adler. Adler Entertainment Trust, dirigée par les fils de l’auteur, figure d’ailleurs parmi les producteurs.
Moins de violence
Celles et ceux qui chercheront les scènes cultes des années 1980 en trouveront donc peu : pas de chien presque transformé en pâté, de sauna piégé, d’acrobaties ou de voiture volontairement broyée avec son occupant à bord. L’humour noir des coups bas cède presque toute la place à un humour sarcastique et so british, finement aiguisé par le scénariste Tony McNamara (La Favorite, Pauvres créatures). Car les Rose sont désormais des Londoniens, expatriés en Californie. Leur amour est plus solide que ne l’était celui de Barbara et Oliver, mais vacille sous la pression de leur ambition commune de tout réussir : carrière, éducation des enfants, vie sociale et conjugale.

À leurs piques assassines, s’ajoutera peu à peu un arsenal moderne, entre deepfakes, réseaux sociaux et domotique, avant d’en venir aux sabotages, couteaux et revolver. Mais c’est précisément dans le traitement de cette violence que le film s’éloigne le plus de son prédécesseur : atténuée pour s’adapter à l’époque post-#MeToo, elle n’explose plus qu’en toute fin de récit. Le titre en VO est d’ailleurs passé de The War of the Roses à The Roses, nuance de taille que la version française n’a étonnamment pas retenue.
Car au lieu d’axer son récit sur un divorce difficile (bien moins inédit au cinéma aujourd’hui), Jay Roach a trouvé son propre souffle et montre que deux personnes peuvent aussi se détruire sans avoir jamais cessé de s’aimer. Pour cela, il explore comment les ressentiments s’immiscent au fil des ans dans les non-dits, comment la soif de réussite finit par dévorer Ivy et Theo et comment, ne sachant plus communiquer, ils ratent toutes les occasions de se montrer qu’ils ne veulent surtout pas se perdre.
Plus sympa qu’un loup
Cette lente implosion, loin d’ennuyer, fournit les moments les plus drôles. Le film démarre d’ailleurs en trombe avec une séance chez une conseillère conjugale dénuée d’humour, face aux Rose qui, eux, en débordent. Ivy et Theo doivent énumérer dix choses qu’ils apprécient encore chez l’autre. « Je préfère vivre avec elle qu’avec un loup », lance Theo. « J’aime qu’il ait des bras », réplique Ivy. Il poursuit : « Sa tête a une forme plutôt agréable… de loin. J’ai le souvenir qu’elle a déjà eu de l’esprit. Parfois, elle sent bon. » Il n’a rien noté de plus. Quant à Ivy, ses neuf autres points ne sont qu’insultes fleuries. Theo éclate de rire, conquis par la répartie de sa femme. Elle rit avec lui. Le couple est sauvé, pour cette fois.

Un flash-back nous ramène ensuite, à Londres, pour assister au début express de leur histoire d’amour. Puis direction la Californie, dix ans après leur rencontre : ils ont des jumeaux, une belle maison. Lui, architecte épanoui, est sur le point de connaître la gloire. Elle, cheffe talentueuse, a renoncé à ses projets culinaires pour s’occuper des enfants. Theo veut réparer cette injustice : il lui offre un restaurant face à l’océan. Ivy le baptise We’ve Got Crabs, qui se traduit par « Nous avons du crabe », mais aussi par « Nous avons des morpions », expliquant sans doute l’absence de clients. Jusqu’au jour où, le hasard fait que son affaire décolle au moment même où la carrière de son mari s’effondre.
Trame déconcertante, toutefois, pour un film de 2025 : c’est précisément lorsque la femme réalise enfin ses rêves professionnels et que l’homme devient père au foyer – tout en s’y investissant pleinement – que le mariage prend l’eau. Un choix narratif qui déroute, tant il semble en décalage avec l’évolution de la société.
Des seconds rôles inégaux
Tout au long de cette comédie, Olivia Colman et Benedict Cumberbatch, également coproducteurs, transforment chacun de leurs échanges en feu d’artifice. Ce qui est loin d’être le cas pour certains seconds rôles cantonnés jusqu’à l’ennui dans la caricature, pour insister lourdement sur les différences culturelles entre Anglais et Américains.
Quant à Andy Samberg, drôle, comme toujours, dans le rôle du meilleur ami (même s’il reste proche de son Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine), il est aussi desservi par le personnage sans nuance d’Amy, son épouse. Ce rôle agaçant, dont son ancienne collègue du Saturday Night Live Kate McKinnon (L’espion qui m’a plaquée, Barbie) a eu la malchance d’hériter, semble davantage avoir été écrit pour Dinner for Schmucks que pour La guerre des Rose.

On appréciera d’autant plus la très belle (mais trop brève) prestation de l’actrice oscarisée Allison Janney (Moi, Tonya, The Diplomat), parfaite en avocate coriace, ainsi que celles, également sous-exploitées, de Sunita Mani (Glow) et Ncuti Gatwa (Sex Education, Doctor Who), employés du restaurant.

Verdict : il faut voir La guerre des Rose version 2025, mais surtout (re)voir celle de 1989. Pas seulement pour la qualité de jeu de leurs duos respectifs, mais parce que chacun des films se déguste dans son registre : l’un comme une grande comédie noire déjantée et féroce, l’autre comme une comédie moins percutante, mais quand même délicieusement hilarante.
La Guerre des Rose (The Roses), de Jay Roach, 1h45, actuellement en salles.