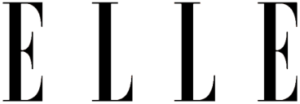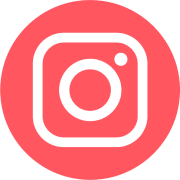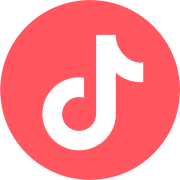Pourquoi avez-vous l’impression de pleurer plus que les autres?
Après une vie passée à dévorer tous les genres de cinéma, l’autrice Lynn Enright a voulu comprendre chez ELLE pourquoi ses canaux lacrymaux étaient à ce point plus productifs que ceux des autres.

Difficile de décrire avec exactitude à quel point Dog Man (2023) frôle l’absurde. Adapté d’une série de romans graphiques pour enfants, le film met en scène une créature hybride — mi-chien, mi-homme — qui fait régner la justice dans une ville américaine. Le Guardian y voit « une avalanche de gags farfelus », tandis que le New York Times souligne que « l’humour suit la logique hasardeuse d’une balle de tennis lancée par Dog Man lui-même ». Imaginé pour le grand public et sachant qu’il s’agissait du seul film pour enfants programmé cet après-midi-là sous une pluie battante, il me semblait tout indiqué comme première expérience au cinéma pour ma fille de trois ans. Mais à mi-parcours, lors d’une scène étrangement mélancolique où un jeune chat se voit abandonné par celui qui l’a cloné (oui, c’est aussi absurde que ça en a l’air), j’ai surpris le visage de ma fille, inondé de larmes silencieuses. Et là, j’ai compris que je m’étais trompée.
En la ramassant dans l’obscurité, l’enveloppant tendrement dans le hall d’entrée, j’ai été frappée par la singularité de ses pleurs. D’ordinaire, elle pleure pour des broutilles – une petite blessure, une résistance à se laver les mains après les toilettes, ou simplement parce qu’elle a trois ans. Mais ce soir-là, ses larmes étaient différentes : plus silencieuses, plus abondantes. Elle pleurait comme une adulte, comme… moi. Tandis que des éclats de rire d’enfants résonnaient autour de nous au cinéma, je me suis souvenue de ce moment où, en 2015, à Brooklyn, un film de Saoirse Ronan m’avait fait pleurer à tel point que j’avais dû enlever mon pull, devenu trop trempé de larmes.
Merci la génétique
Bref, je suis une grande pleureuse : je pleure devant les informations, lorsque des amis partagent leurs peines, et bien sûr, chaque fois que Saoirse Ronan fond en larmes à l’écran (je me rappelle de mon pull trempé lors de son discours poignant « Je suis si seule » dans Les Filles du Docteur March en 2019). En essuyant les larmes de ma fille, j’ai réalisé que j’avais sans doute transmis ce penchant pour les pleurs.
« Il est prouvé que notre tendance à pleurer est génétiquement déterminée », confirme le Dr Ad Vingerhoets, professeur de psychologie clinique néerlandais et expert international des larmes, lorsque je l’interroge sur cette dimension héréditaire. Il est également juste de penser que grandir dans un environnement où l’on voit souvent sa mère pleurer facilite la prise de conscience et le confort vis-à-vis de l’expression émotionnelle par les larmes, selon lui.
Contact avec l’autre
D’accord, je dois donc accepter une part de responsabilité dans la propension de ma fille à pleurer… Mais pourquoi pleurons-nous, au fond? Pourquoi l’un d’entre nous ressent-il ce besoin irrésistible de verser des larmes? Les humains sont les seuls à pleurer des larmes émotionnelles: les animaux, eux, hurlent et gémissent, mais ces sanglots, ces pleurs humides, seuls les humains les connaissent.
« La raison pour laquelle nous pleurons est liée à un besoin profond de soutien ou de réconfort des autres, explique le Dr Vingerhoets. Dès le plus jeune âge, ce besoin se manifeste par la recherche de nourriture, de contact physique et de chaleur. Mais à mesure que nous grandissons, nos pleurs sont motivés par le désir de réconfort. En réalité, la raison de nos larmes demeure inchangée : nous cherchons à établir une connexion avec autrui. Et lorsque les autres nous voient pleurer, cela suscite chez eux un sentiment d’empathie, une volonté instinctive de nous apporter leur aide. »
Mais nous pleurons pour de nombreuses autres raisons: face à une perte, une frustration, un stress, ou encore lorsqu’une expérience nous touche profondément. Mais, fondamentalement, nous pleurons lorsque nous nous sentons petits, vulnérables et impuissants.
Entre intelligence émotionnelle et névrose
A mesure que nous vieillissons, la nature de nos pleurs change. « Les aspects acoustiques des pleurs diminuent et les larmes deviennent plus significatives », explique le Dr Vingerhoets. Ainsi, les pleurs plus discrets et silencieux de ma fille, durant Dog Man, témoignent d’une maturité grandissante. La propension à ce type de pleurs émotionnels se développe tout au long de l’enfance et se renforce particulièrement à l’adolescence. Si presque tous les humains pleurent un jour ou l’autre, certains (comme moi) pleurent bien plus que d’autres.
Des experts relient cette tendance à pleurer, notamment devant un film triste, à l’intelligence émotionnelle. Le Dr Debra Rickwood, professeur de psychologie à l’Université de Canberra, explique: « Pleurer devant un film révèle une empathie, une conscience sociale et des liens forts, autant d’aspects de l’intelligence émotionnelle. C’est un indicateur de force personnelle, pas de faiblesse.
Mais ce qui est moins flatteur pour les grands pleurants, c’est que cette tendance est également associée à la névrose, ce trait psychologique désignant une prédisposition à ressentir des émotions négatives telles que la colère, l’anxiété, l’instabilité émotionnelle, ou encore la dépression.
Influence hormonale
Les femmes pleurent généralement plus que les hommes, pour plusieurs raisons, et certaines études, bien que limitées, suggèrent que les fluctuations hormonales liées au cycle menstruel rendent celles-ci plus enclines à verser des larmes à certains moments du mois. (Cela me semble tout à fait plausible, et une amie actrice m’a même confié qu’elle arrivait à jouer la désolation beaucoup plus facilement juste avant ses règles.) Des facteurs comme le manque de sommeil ou la consommation d’alcool influencent également la facilité avec laquelle nous pleurons, étaye le Dr Vingerhoets, car ces conditions réduisent nos inhibitions.
Il existe une croyance populaire selon laquelle pleurer serait même cathartique — mieux vaut extérioriser que retenir, comme le dit l’adage. Pourtant, les recherches ne confirment pas nécessairement cette idée. Dans une étude menée par le Dr Vingerhoets et son équipe, ils ont constaté que, dans 50 % des cas, les personnes se sentaient mieux après avoir pleuré, tandis que 40 % n’ont remarqué aucun changement, et 10 % ont même signalé un sentiment de détérioration.
« Ce qui importe profondément, c’est la manière dont les autres réagissent à vos pleurs, souligne-t-il. Si leur réponse est empreinte de compréhension et de soutien, vous vous sentirez soulagé. Mais si les gens réagissent par la colère, la moquerie ou vous font honte de pleurer sans raison, alors vous vous sentirez mal. »
Une pensée à garder à l’esprit la prochaine fois que quelqu’un pleurera, que ce soit un collègue, un partenaire, un inconnu dans les transports, ou même un personnage de Dog Man: les larmes sont souvent un appel au réconfort, et parfois, un simple sourire peut suffire à apporter ce soulagement.
Autrice: Lynn Enright
Cet article a été traduit en français et adapté pour la Suisse après avoir initialement été publié sur elle.com/uk. Retrouvez tous les autres articles de cette édition sur le site web officiel.