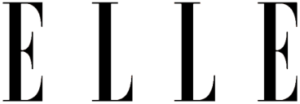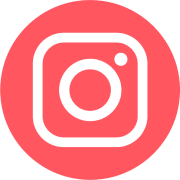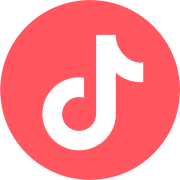Rencontre avec Justine Mettraux
Aujourd’hui, à 36 ans, la Genevoise d’origine fribourgeoise fait plus que jamais partie des meilleurs skippers du monde. Interview exclusive alors qu’elle prendra part l’an prochain à la course ultime, le Vendée Globe.
Justine Mettraux, cheveux aux vents, est toujours en train de sillonner les mers aux quatre coins de la planète. Dix ans après ses débuts dans la Transat en solitaire, sa passion n’a pas pris une ride. Après avoir fini 7e et première femme de la dernière Route du Rhum, elle vient en juin dernier de gagner l’Ocean Race, la course autour du monde en équipage avec «11th Hour», le bateau américain. En novembre 2024, elle deviendra la première Suissesse à participer au Vendée Globe, le tour du monde en solitaire et sans escale, une folle aventure de quelque trois mois loin de tout. Elle nous raconte ses espoirs et ses angoisses.
Le Vendée Globe, c’est le rêve ultime?
Oui, complètement. Y participer, c’est l’aboutissement de toute carrière de marin et j’ai cette chance-là.
Vous visez un top 10?
J’espère mais tout cela est très aléatoire. Il peut y avoir des abandons. Il y aura plein de bateaux neufs avec de super skippers, on verra.
Vous allez rester environ trois mois seule en mer, beaucoup plus longtemps que tout ce que vous avez connu jusqu’ici. Ce n’est pas angoissant?
La plus longue course que j’ai faite en solitaire a duré 22 jours et le record du Vendée est de 74 jours. C’est dire que l’écart est important. Cette angoisse, je ne la ressens pas encore, mais je pars dans l’inconnu, c’est évident. Comme tous les skippers de haut niveau, je travaille avec un préparateur mental, qui m’aide à gérer le stress, la pression. Il me sera forcément très utile pour le Vendée Globe.
Vous allez traverser les mers du Sud, connues pour leurs conditions extrêmes, les tempêtes, le froid, les icebergs.
J’y suis déjà allée, mais en équipage, lors de la dernière Ocean Race et paradoxalement les conditions étaient assez clémentes. Les zones d’icebergs, on les évite grâce à la nouvelle réglementation de la course. Mais bien sûr qu’on peut s’attendre à du gros temps surtout qu’il n’y a aucune terre pour l’atténuer. La température dépasse rarement les cinq degrés.
Vous avez réuni un budget de quelque deux millions en bonne partie grâce à Teamwork, l’entreprise genevoise de numérique, qui vous soutient depuis vos débuts. Une belle histoire de fidélité?
Oui, c’est vraiment chouette. Bien au-delà du financement, j’entretiens avec Philippe et Valérie Rey-Gorrez, qui dirigent l’entreprise, des relations amicales, familiales.
En 2013, vous aviez fini deuxième de votre première grande couse, la Transat en solitaire. Dix ans plus tard, votre passion reste intacte?
Il n’y a pas moyen de se lasser quand on navigue à ce niveau. Le contact avec la nature est sans pareil et la technologie des bateaux qui évolue sans cesse oblige à se tenir à jour en permanence. En plus, les courses sont très différentes, seule, à deux, en équipage.
Quels sont les plus beaux moments lorsqu’on est seule en mer?
On a toujours un sentiment de grande harmonie quand le bateau glisse sans problème sous un beau ciel étoilé. On fait aussi de belles rencontres avec la faune. Ça fait toujours plaisir de croiser des dauphins, des baleines. Et on a du temps pour méditer, penser à nos proches, à nos vies.
Septième et première femme de la dernière Route du Rhum, vous êtes une star de la voile aujourd’hui, malgré votre légendaire modestie.
Je ne me considère pas ainsi. J’ai la chance de naviguer dans les plus grandes compétitions avec de super marins. Mais dans ce sport, il y a toujours moyen de progresser et je garde les pieds sur terre.
À la Route du Rhum, vous n’étiez que sept femmes sur 138 participants. C’est décevant?
Oui. Les exploits d’Ellen MacArthur ou Florence Arthaud remontent à il y a très longtemps. Côté féminin, on manque d’exemples récents auxquels s’identifier. Et pourtant des efforts sont entrepris pour inverser cette tendance, pour encourager la mixité. Le règlement de l’Ocean Race, par exemple, oblige chaque équipage à compter au moins une femme.

La voile est pourtant l’un des seuls sports où les femmes partent quasi avec les mêmes chances que les hommes comme en témoigne la deuxième place d’Ellen MacArthur au Vendée de 2001.
Lors des manœuvres, très physiques, les hommes ont un avantage. Mais il y a plein d’autres paramètres comme les choix météo, la stratégie où nous n’avons aucun handicap.
En août, on vous a revu sur le Léman, où tout a démarré, lors de la Translémanique en solitaire. Vous avez dû recevoir un bel accueil?
Je n’y avais plus fait de course depuis mon départ à Lorient voilà 12 ans. C’était sympa de revoir ceux avec qui j’ai commencé, les membres de la Société nautique de Genève qui m’ont toujours soutenue.
Vous avez attrapé le virus avec vos parents au large de Versoix. Aujourd’hui, vous et vos quatre frères et sœurs êtes tous marins professionnels. C’est assez unique?
Oui, d’autant que nos parents, loin de nous pousser, avaient de toutes autres attentes pour nous. Bryan mon petit frère fait partie de l’équipe d’Alinghi. Quand engagée ailleurs, je ne peux pas prendre part à une course en équipage, je propose une de mes sœurs. Et souvent ça marche non pas à cause de nos liens mais parce qu’elles sont très compétentes. Entre nous, on se comprend, on se soutient. Et devinez quel est le principal sujet de discussion lors des réunions de famille, à Noël notamment?
Peut-on avoir vie privée quand on navigue à votre niveau?
Il y a forcément de longues périodes où on est engagé en mer, mais l’un peut très bien aller avec l’autre.